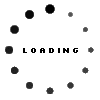Du 3 au 11 septembre, Marseille accueille le Congrès mondial de la Nature de l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN). Poussés par l’horloge climatique et par la pression démographique, les gardiens de la biodiversité africaine inventent des solutions qui leur permettent aujourd’hui de conjuguer développement économique et protection de la biodiversité.
Organisé en amont de la 15e Conférence des parties (COP15) de la Convention de Rio sur la diversité biologique (CDB), le Congrès mondial de la nature de l’IUCN réunira dans la cité phocéenne, chefs d’Etat et de gouvernements, mais aussi acteurs de la société civile engagés dans la conservation de l’environnement, scientifiques, collectivités territoriales, institutions philanthropiques, banques de développements, fonds d’investissements et enfin secteur privé. Trois thèmes majeurs y seront abordés : la sortie de crise pandémique reposant sur des solutions liées à la nature, l’élaboration d’actions convergentes en faveur du climat et de la biodiversité et enfin, la mise en place d’actions sur des sujets sociaux liés à l’environnement.
« L’enjeu principal reste celui de la mobilisation à l’heure où la biodiversité est en train de se détériorer à très grande vitesse, en lien avec la crise climatique, la surexploitation des ressources et les pollutions », explique Gilles Kleitz, écologue spécialiste de la conservation de la nature et directeur technique en charge de l’agriculture, de l’eau, de la biodiversité au sein de l’Agence française de développement (AFD).
Les experts estiment que la dégradation de la biodiversité est essentiellement liée à la surexploitation des terres, au facteur climatique, à la pollution et à la multiplication d’espèces invasives. Selon le Rapport Planète vivante 2020 du fonds mondial pour la nature (WWF), les activités humaines sont responsables 68% du déclin des populations de vertébrés en moins de 50 ans.
Le poids de la biodiversité dans l’économie réelle
En novembre 2020, à l’occasion du Sommet Finance en commun (FICS), quel que 450 banques publiques de développement (BPD) signaient une déclaration commune relative à la nécessité d’un financement spécifique pour la biodiversité, se disant « prêtes à faciliter l’alignement de tous les flux financiers sur le futur Cadre mondial pour la biodiversité post-2020 qui doit être adopté lors de la COP 15 ».
Les intentions sont affichées, mais le temps presse, car la biodiversité est menacée par des défis de toutes natures. Les prévisions du rapport du Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC) paru le 9 août, sont catastrophistes et les objectifs affichés lors de la COP21 en 2015, sont loin d’être tenus. Selon ses conclusions, la température de la planète devrait augmenter de +1,5°C dès 2030, soit 10 ans plus tôt que prévu (d’après le pire des scénarios étudiés, la température pourrait grimper de +3,3°C à +5,7°C).
« En France, la politique des parcs nationaux coûte environ 60 millions d’euros au contribuable par an, mais les retombées locales sont de l’ordre de 900 millions d’euros à 1 milliard d’euros. Pour 1 euro investi, c’est 10 fois plus de bénéfice au minimum. La nature paye », souligne Gilles Kleitz, pour lequel il faudrait investir beaucoup plus. Selon une étude publiée en septembre 2020 par Swiss Re Group (société suisse d’assurance et de réassurance), 55 % du PIB mondial, soit 41,7 milliards de dollars, « dépend d’une biodiversité et de services écosystémiques qui fonctionnent bien ».
La préservation de l’environnement a un coût, mais elle représente également des opportunités pour le secteur privé. En Ouganda, si le service pay-as-you-go de « taxi-moto » électriques, rechargées grâce au raccordement au réseau dans la capitale, ou via des panneaux photovoltaïques, est soutenu par les autorités locales, c’est bien le secteur privé qui en est à l’origine (la start-up Zembo). « Il y a une prise de conscience du secteur privé que les risques en matière de biodiversité sont aussi importants que les risques climatiques. Le dernier rapport du forum économique mondial a d’ailleurs affirmé que la perte de la biodiversité faisait partie des risques les plus importants, en termes de développement des entreprises », explique Stéphanie Bouzigues-Eschmann, la secrétaire générale du Fonds français pour l’Environnement mondial (FFEM) qui a financé le projet de « boda-boda » ougandais sans diesel.
L’AFD vise 1 milliard d’euros par an pour protéger la biodiversité d’ici 2025
Le groupe AFD désormais labellisé « 100% Accord de Paris », aux côtés du gouvernement français dans l’organisation du Congrès mondial de la nature de l’IUCN, ne ménage pas ses efforts pour entraîner ses homologues dans son sillage. A la tête de l’International Development Finance Club (IDFC) qui regroupe 26 banques publiques de développement (BPD), Rémy Rioux, le directeur général du groupe incite les BPD à renforcer leurs financements à co-bénéfices positifs pour la biodiversité, avec force conviction et à grand renfort de communication.
A ce jour, les besoins relatifs à la préservation des écosystèmes seraient compris entre 722 milliards de dollars et 967 milliards de dollars par an d’ici 2030, selon les études révélées dans le « Little Book of Investing in Nature », paru en janvier 2021. L’AFD porte plusieurs projets centrés sur la biodiversité à l’instar de la « Grande Muraille Verte » en Afrique, qui ambitionne de restaurer 100M ha de terres dégradées d’ici 2030, sur une bande saharo-sahélienne longue de 8 000 kilomètres, du Sénégal à Djibouti, en passant par la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l’Erythrée et l’Ethiopie.
A l’origine d’une « Taskforce on Nature-related Financial Disclosures » (qui réunit acteurs publics et privés pour évaluer les risques financiers liés à l’effondrement des écosystèmes), le groupe AFD annonçait en janvier, que 30% de ses financements climat auront un co-bénéfice biodiversité d’ici 2025. L’année dernière, la banque consacrait 527 millions d’euros à la protection de la biodiversité et porte aujourd’hui l’ambition de passer à 1 milliard d’euros par an à l’horizon 2025, pour supporter des projets en agro-écologie, assainissement, gestion des océans, des forêts et des bassins versants, tout en accompagnement le développement des communautés locales. Conjuguer développement économique et préservation de l’environnement, c’est également le message porté par le Fonds français pour l’Environnement mondial (FFEM)…
Pour le FFEM, développement et préservation sont indissociables
Le Fonds français pour l’Environnement mondial, créé par la France en 1994 après le Sommet de Rio, en parallèle à la création au GEF (Global Environment Facility, un fonds multilatéral basé à Washington), est un outil bilatéral créé pour accompagner les populations locales dans la mise en œuvre de solutions durables. « L’objectif du FFEM est de conjuguer développement et protection de l’environnement […] Sur plus de 350 projets relatifs aux forêts et à l’agriculture durable, mais aussi à la préservation de la biodiversité, aux écosystèmes aquatiques, à la transition énergétique et à la lutte contre les pollutions que nous avons soutenues depuis plus de 25 ans, 70% étaient basés en Afrique [pour 293 millions d’euros engagés, ndlr] », souligne Stéphanie Bouziges–Eschmann.
Le petit livre de l’investissement pour la Nature, publié en janvier 2021, révèle que 76 % du financement annuel requis pour stopper et inverser la perte de biodiversité mondiale se rapportent à la nécessité d’adopter un modèle de préservation intégré de la biodiversité. C’est dans cette optique que le FFEM soutient notamment le projet « Faufopopu » lancé en 2018 par le Museum d’Histoire naturelle et par la primatologue Sabrina Krief qui suit une population de chimpanzés dans le parc de Kibale en Ouganda. Elle a constaté des malformations congénitales dont les premiers éléments font apparaître un faisceau d’indices qui convergent en direction de l’usage des pesticides.
« Nous travaillons à réduire la pollution liée aux pesticides en transformant les pratiques agricoles vers des usages agro-écologiques et d’agriculture biologique. Nous cherchons aussi à réduire les conflits homme-faune, en priorisant des cultures moins attractives pour les animaux », poursuit Stéphanie Bouzigues-Eschmann. « Nous visons à maximiser l’impact des solutions au bénéfice des populations locales […] toutes les problématiques environnementales sont interconnectées. Il faut donc les traiter de manière intégrée (biodiversité, climat, dégradation des terres, pollution) », conclut-elle.
Le prochain Congrès mondial pour la nature de l’IUCN organisé tous les quatre ans, sera l’occasion pour le FFEM de revenir sur les quinze ans du Programme de petites initiatives (PPI), développé en Afrique de l’Est, de l’Ouest et du Nord, pour faire émerger la société civile environnementale et pour construire des projets pilotes avec les populations locales, à l’instar du projet « Weeecam » (Waste Electronic and Electric Waste), élaboré par l’ONG Solidarité technologique (ST), qui collecte, trie, retraite et recycle des déchets à Yaoundé, avec le BRGM (établissement public français spécialisé sur les minerais). Une fois retraités, les composants sont réintégrés dans le circuit productif dans le cadre d’une économie circulaire. « Ce projet enregistre de bons résultats, mais il est en souffrance, car le secteur des déchets dangereux -en particulier électriques et électroniques- est encore trop peu couvert par les bailleurs », regrette-t-elle.
Les paysans namibiens, champions des « conservancies »
En Afrique, les communautés locales ne ménagent pas leurs efforts pour préserver la biodiversité, stimulées par de nouvelles incitations gouvernementales.
« Il existe sur le continent africain, des paiements pour la conservation. Les agriculteurs peuvent être rétribués pour maintenir des forêts en bon état. C’est notamment le cas à Madagascar. Au Kenya, les initiatives locales pour protéger des bassins versants sont aussi récompensées », précise Gilles Kleitz. « Nous accompagnons en Namibie et au Kenya, de nouveaux modèles de conservation, les « conservancies » [réserves naturelles gérées par les communautés locales, ndlr]. Dans le Parc Meru au Kenya, cela fonctionne très bien », explique Stéphanie Bouzigues-Eschmann.
Suivant un protocole strict, les populations protègent leurs intérêts économiques liés aux cultures vivrières et à l’économie du tourisme en protégeant la faune (le ticket d’entrée d’une rencontre avec les derniers gorilles des montagnes coûte plusieurs centaines de dollars, auquel s’ajoutent les Resorts de luxe et la rémunération des pisteurs). Pionniers en matière de « conservancies », la Namibie en compte plus de 80 réparties sur 20% de son territoire. Cet exemple est désormais reproduit au Kenya ou en Afrique du Sud.
Le Congrès mondial pour la nature de l’IUCN permettra aux acteurs locaux de la protection de l’environnement, de mettre en lumière, ce type de projet à impact, reproductible sur un continent confronté à l’accélération de la conversion de ses espaces naturels. « A l’heure actuelle, la forêt du bassin du Congo est grignotée par les besoins en terres pour l’agriculture vivrière, mais également par les grandes exploitations agricoles et forestières ou encore, par les concessions minières. La conversion d’habitat naturel en habitat dégradé représente le 1er facteur d’érosion de la biodiversité dans le monde (…) il faut coordonner la planification spatiale, l’intensification écologique et établir une meilleure utilisation des terres », prévient Gilles Kleitz, qui considère le grand rendez-vous de l’IUCN, comme un « cri de ralliement » pour tous les acteurs engagés dans la protection de la biodiversité.