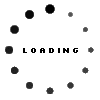Aux commandes du Fonds pour le développement des exportations en Afrique (FEDA) qui pèse 670 millions de dollars, Marlène Ngoyi évoque le rôle clé de cette organisation dans la révolution des expéditions de produits africains qui est en cours de gestation. Celle dont la nomination, il y a un an, a suscité l’enthousiasme au-delà des frontières africaines, partage en outre son équation gagnante de l’Afrique dans le commerce mondial.
Expert financier, vous avez travaillé aux Etats-Unis, en Europe et en Afrique et votre nomination à la tête du FEDA en mai 2022 a suscité beaucoup d’enthousiasme au sein de la sphère business africaine et internationale. Vous êtes la première personnalité à diriger ce fonds dont l’un des mandats est d’amplifier le positionnement de l’Afrique dans le commerce extérieur. Comment le vivez-vous ?
MARLENE NGOYI – Premièrement, je pense que j’ai beaucoup de chance parce que pour quelqu’un qui évolue dans le secteur de la finance, c’est vrai que j’ai un très haut niveau d’engagement avec des gens qui ne sont pas forcément dans le secteur. Et je pense que mon niveau d’engagement fait qu’en général les nominations suscitent beaucoup d’intérêt… Cela arrive aussi, je dirais parce que j’ai fait le choix du concret. Vous me voyez de temps en temps à des conférences, mais je peux vous assurer que la plupart du temps, je suis à mon bureau ou chez moi en faisant des nuits blanches pour faire du concret. A mon avis, c’est ce que les gens le reconnaissent. J’arrive souvent aux conférences cernée parce que j’ai travaillé avant et que je travaillerai après… C’est cela ma marque de fabrique. En général, j’essaie de dire ce que je fais, de faire ce que je dis.
En plus, j’ai aussi la chance d’être de la République démocratique du Congo, un pays qui fascine, à raison. Le fait qu’il y ait peu de femmes congolaises dans la haute finance, rend ce genre de nominations encourageantes et les gens ont envie d’applaudir et en voir plus. En plus, j’ai aussi évolué en Afrique de l’Est et en Afrique centrale. J’ai donc été sur le terrain et c’est un parcours qui est partagé de manière très transparente.
FEDA vient d’être désigné manager du Fonds d’ajustement de la Zlecaf lourd de 10 milliards de dollars. Dans le cadre de votre mission de base, vous accompagnez des entreprises sur le continent et initiez des projets d’envergure. Comment orchestrez-vous tout cela ?
En effet, nous sommes heureux d’être désignés manager du Fonds d’ajustement de la Zlecaf, dans lequel notre fondateur – Afreximbank – a engagé un milliard de dollars. Cela va jouer un véritable rôle accélérateur dans le processus de déploiement du libre-échange africain.
Au niveau du FEDA, le chemin parcouru jusqu’ici est satisfaisant, parce que nous avons fait beaucoup en peu de temps et avec peu de ressources, mais avec beaucoup d’énergie. L’institution existe certes depuis 2018-2019, mais a, en effet, officiellement démarré ses activités en 2021 et dispose d’ailleurs depuis le début de l’année en cours d’un nouveau siège à Kigali, au Rwanda, où travaille d’arrache-pied une équipe panafricaine. Nous nous sommes tout d’abord assurés d’avoir les moyens de notre politique afin de créer un impact réel en finalisant, en septembre 2022, notre premier closing de 670 millions de dollars. Cela nous classe non loin des plus grands fonds d’investissement présents en Afrique et dont les actifs oscillent généralement autour du milliard de dollars.
Nous avons en outre finalisé toutes les stratégies d’investissement de ces fonds, au travers de quatre initiatives : la première est notre fonds d’investissement direct grâce auquel nous misons dans les entreprises qui font de l’industrialisation, celles qui ont des stratégies d’expansion panafricaine et celles qui exportent vers le reste du monde. Aujourd’hui, Arise IIP – à qui nous avons alloué 85 millions de dollars – en est un parfait exemple, au regard de ce qu’ils font dans l’industrie du bois au Gabon, du coton au Bénin ou de la viande au Tchad.
Notre deuxième initiative a exactement la même thèse d’investissement mais il s’agit d’un fonds de dette qui applique des conditions plus flexibles que la banque, en termes de maturité et d’échéancier. Nous avons ensuite notre fonds d’initiatives stratégiques auquel nous avons alloué 250 millions de dollars et qui a démarré avec une particularité, celle de nous voir investir nous-même dans un projet important pour l’Afrique : la santé. Au lieu d’attendre qu’un entrepreneur décide de le faire, qu’il grandisse et devienne bancable… nous sommes en train de construire un hôpital de 500 lits à Abuja au Nigeria, qui sera spécialisé en oncologie, en cardiologie et en hématologie. Nous en aurons terminé la construction d’ici 18 ou 24 mois, si tout va bien et procéderons à son ouverture. C’est un projet que nous comptons répliquer sur le continent, afin d’avoir des centres de santé de premier plan pour soigner les Africains, aux meilleurs standards possibles. Cela permettra de rompre avec la tendance à aller se faire soigner à l’étranger.
Vous faites aussi dans le capital-risque qui a le vent en poupe sur le continent ces dernières années. Quelle est votre philosophie sur ce créneau et comment déployez-vous vos financements ? Les startups viennent-elles à vous ou c’est vous qui allez à la recherche de ces pépites entrepreneuriales ?
Notre fonds de capital-risque, qui constitue la quatrième initiative de notre stratégie et pèse 25 millions de dollars, s’adresse aux plus petites entreprises – souvent portées par des jeunes ou des femmes – et vise à soutenir les industries créatives et culturelles : cinéma, musique, mode, technologies… De plus, ces entreprises n’ont pas uniquement besoin de capital, mais aussi d’accompagnement en termes de développement et de gouvernance pour s’assurer de leur succès.
De manière pratiquement, le contact avec les entreprises bénéficiaires de ces fonds est à double sens. Une grande partie de notre métier étant la recherche d’opportunités, nous allons vers elles, tout comme elles viennent à nous. Il ne faut pas nous présenter juste une idée, parce que nous ne sommes pas un incubateur. Il faut plutôt présenter une petite entreprise structurée (business plan, proof of concept, petite équipe …), quelque chose qui donne envie de vous accompagner afin d’aller plus loin.
La montée en puissance du commerce de l’Afrique avec le reste du monde est récemment au cœur des débats, pour que le continent ne soit plus seulement un exportateur de matières premières, mais aussi de produits finis, notamment vers l’Europe qui trône dans le club des partenaires commerciaux de l’Afrique. Que représente cet enjeu dans la stratégie que vous pilotez ?
C’est un enjeu fort important. Premièrement, il faut chez nous un changement d’état d’esprit, car lorsque des pays et des entreprises passent des commandes, ils ou elles le font très rarement par charité. Ils le font parce qu’ils trouvent un produit dont ils ont besoin, qui est de qualité et à un prix acceptable. Le standard est donc défini. Personne ne nous fera donc des commandes pour nous faire plaisir. Cela n’arrive que très peu et c’est très cyclique. C’est la raison pour laquelle au FEDA, nous travaillons pour un export africain de qualité. Il faut que nous puissions transformer chez nous de telle sorte qu’une fois arrivé au port de Marseille, de Shanghai ou de New York, le produit soit moins cher que s’il avait été produit localement ou la matière première venue d’Afrique. Et nous devons pouvoir arriver à ce niveau-là. Or, y parvenir signifie industrialiser nos économies.
L’industrialisation, c’est littéralement prendre des matières premières, des machines, de l’énergie, des processus et de transformer. Ainsi, vous avez déjà une idée de ce qu’il faut impérativement régler pour arriver à ces industrialiser.
Quelle serait alors, selon vous, l’équation gagnante pour un export africain de qualité dans le monde ?
La première chose, c’est l’énergie. Il nous fait une énergie au coût compétitif, car si on fait tourner les équipements toute la journée sur générateur, il est impossible d’être compétitif face à une production dont les coûts énergétiques sont faibles. Une fois que vous avez l’énergie, les machines, il faut travailler sur l’efficience. Les Japonais en sont un exemple, quand on voit comment ils ont réussi à « masteriser » l’efficience en permettant aux gens de prendre des photos de leurs usines Toyota en étant certains qu’ils ne réussiront pas à les dupliquer parce que c’est une question de culture et de méthodologie, on est face à une leçon d’efficience. Il nous faut donc en Afrique développer le savoir-faire en formant le capital humain. Après il faut se soucier de l’acheminement de ces produits vers le client ou le consommateur final. Il nous faut donc absolument régler la question des infrastructures : chemins de fer, des ports avec de plus grandes capacités pour des temps d’attente plus courts, des avions cargos, des routes commerciales plus courtes… Et enfin, il faut une information fiable qui permette de faire des études efficaces en amont, afin de définir les stratégies appropriées.
Je dirai donc que l’équation gagnante d’un export africain de qualité dans le monde allie énergie, capital humain, infrastructure et recherche.
Dans le cadre de nos initiatives stratégiques, nous mettons aussi un accent sur la suppression des barrières non tarifaires qui passe aussi par le niveau de qualité de nos exportations entre pays africains et vers le reste du monde. A cet effet, avons finalisé le développement d’un centre d’assurance qualité que nous voulons dupliquer dans quatre autres pays pour justement éviter d’avoir des goulots d’étranglement à ce niveau et permettre aux exportateurs – qu’ils exercent dans le réseau africain ou celui du reste du monde – d’accéder à des centres de qualité agréés pour vérifier que la conformité de ce qu’ils exportent aux meilleurs standards.
Dans le cadre du développement industriel, les pays sont encouragés à miser sur les ressources naturelles ou sur leurs expertises prouvées. Des pays comme le Ghana et la Côte d’Ivoire, riches en cacao, seraient des champions de la chocolaterie, des pays comme le Maroc et l’Afrique du Sud seraient des champions de l’automobile… Ils approvisionneraient les marchés régionaux et porteraient l’Afrique dans le commerce mondial. Partagez-vous cette vision de l’export africain à valeur ajoutée ?
Vous touchez un concept économique qui s’appelle l’avantage comparatif, qui consiste en ce que le pays qui est objectivement le mieux positionné (meilleur coût, capacité à distribuer partout en Afrique, considération pour l’environnement) pour produire tel bien ou tel service devrait le faire à une certaine échelle, afin que cela bénéficie à tous. A mon avis, il s’agit d’une notion importante, au stade où nous en sommes sur notre continent. Car, il y a beaucoup d’industries dont une production à petite échelle générera des coûts encore plus élevés que les coûts d’importation. C’est le cas souvent des raffineries pétrolières qui, en dessous d’une certaine capacité, deviennent tellement onéreuses qu’il vaudrait mieux importer.
Dans les services, c’est cette logique d’avantage comparatif qui a prévalu notamment lors de la fusion de la Bourse de Libreville et la Bourse de Douala. Aucune n’avait assez de volume, elles évoluaient sur le même marché, avaient les mêmes investisseurs… il n’y avait aucune raison d’en avoir deux. Il faut que les gens comprennent que c’est une affaire d’avantage comparatif.
Si un pays ou une entreprise ne trouve pas le moyen d’industrialiser à un coût compétitif, il n’arrivera jamais à battre les prix de la Chine, sachant que parfois, il revient moins cher d’importer d’Asie, transport et autres charges y compris. Il est important de le reconnaître. En revanche, le COVID nous a appris qu’il y a des choses qu’il faudrait absolument produire soi-même, afin de garantir sa souveraineté. C’est le cas, par exemple, de tout ce qui est alimentaire. On se rend compte qu’il est très difficile de dépendre entièrement de l’étranger pour quelque chose d’aussi stratégique et d’aussi essentiel. En raison de cela, ce ne doit pas être l’un ou l’autre, le raisonnement doit être très nuancé. Même en Europe pendant le Covid, on a vu comment la production d’aspirine était un sujet. Fondamentalement, il est important d’avoir une capacité de production nationale dès qu’il est question de sécurité sur le plan national.